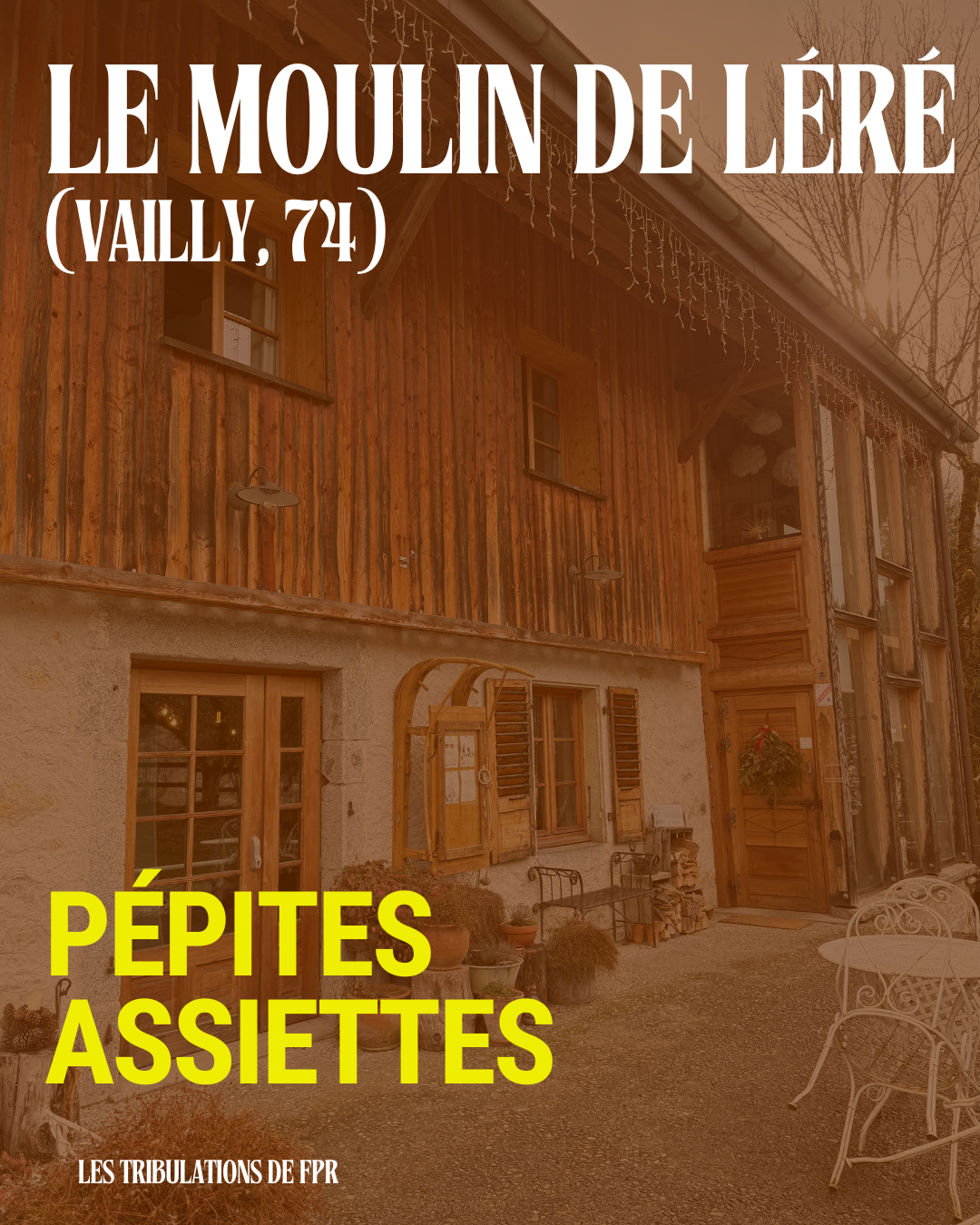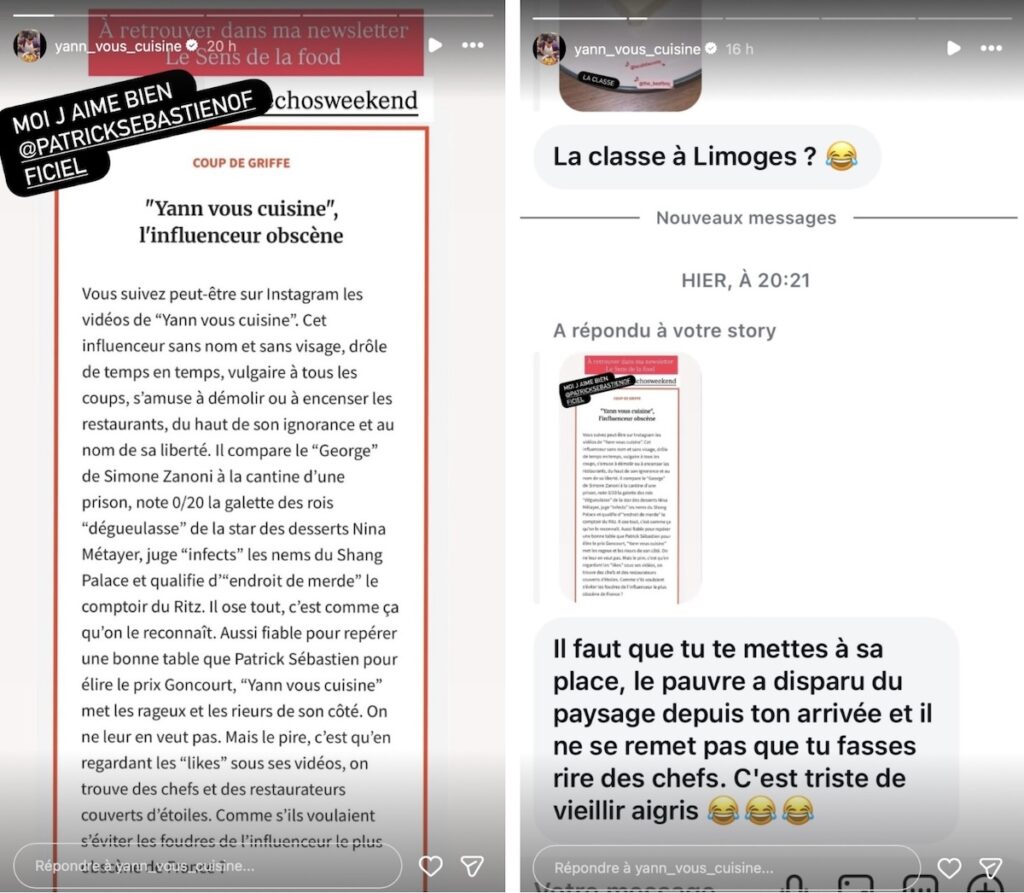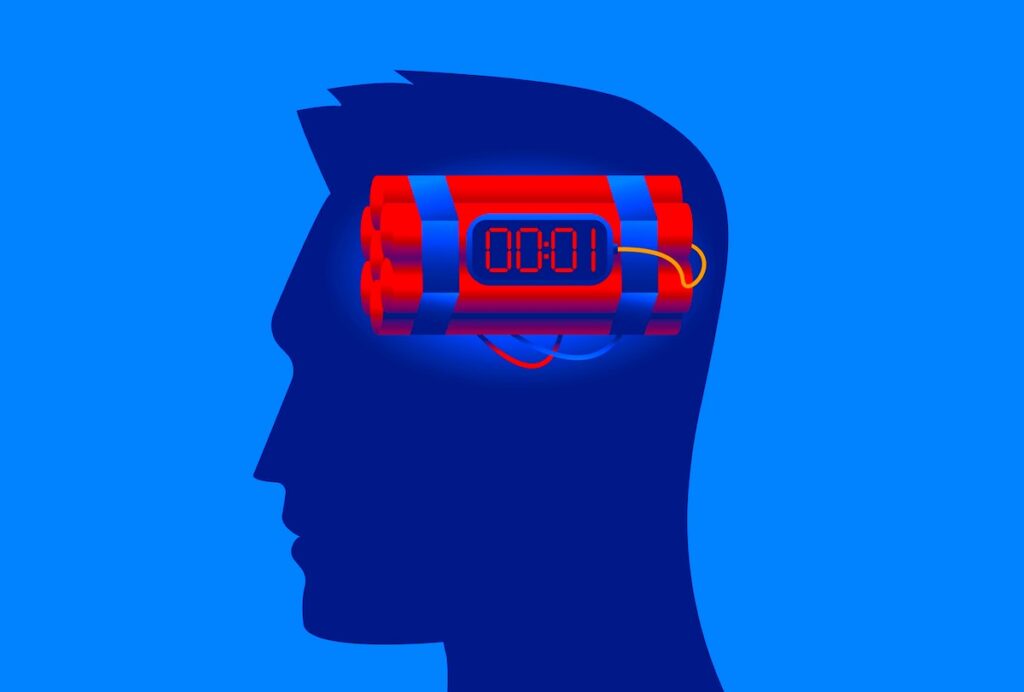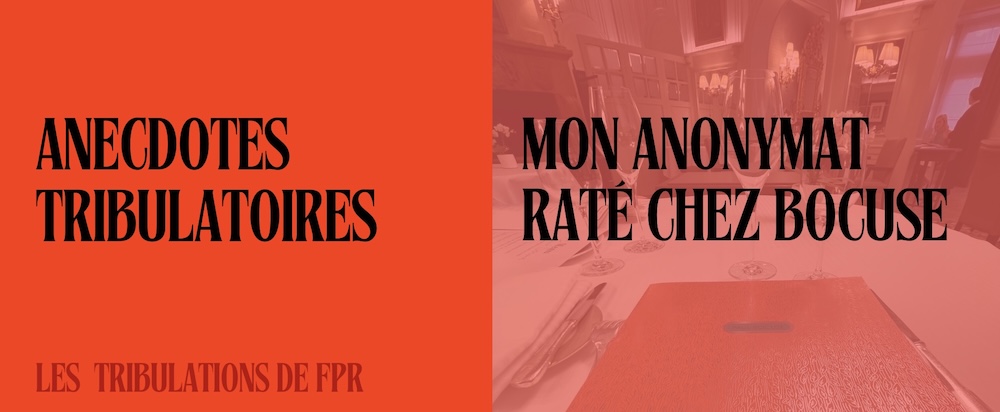Bouillantes | Comment est né le Domaine des Hautes Glaces ?
Frédéric Revol | Le Domaine des Hautes Glaces est la première ferme – distillerie au monde. Je l’ai fondée en 2009 avec l’intention de remettre en question la notion de terroir et de réintroduire la naturalité dans le monde des spiritueux. Etant un grand amateur de vin et de whisky, en explorant la fabrication de ce dernier, j’ai réalisé qu’il y avait un manque à propos de la céréale, c’est-à-dire la matière première même de ces produits. Une opportunité m’est apparue d’explorer de nouvelles possibilités dans le monde du whisky, en mettant l’accent sur la qualité de la matière première, laquelle peut réellement améliorer le goût si elle est bien travaillée. C’est le point de départ. J’ai donc construit une ferme-distillerie ex-nihilo, en Isère, afin de maîtriser l’ensemble des étapes de transformation et de pouvoir faire ce lien entre une manière d’appréhender son environnement, de travailler ses sols, de faire de l’agriculture avec divers types de céréales, et, au bout de la chaîne, du whisky. Cela n’a pas été simple de trouver des partenaires et du financement, car l’idée était originale pour beaucoup, puisque le whisky français n’existait pas en tant que catégorie à l’époque, de même pour les spiritueux bio.
_

_
Dès l’origine, il était prévu de produire en bio ?
Pour moi c’était une évidence à plusieurs titres. Le but étant d’interroger une matière première et un territoire, il convenait de sortir de la chimie, laquelle vient contraindre et masquer ce que le vivant peut nous offrir. Mais il y avait aussi une approche plus sociétale : la vision d’une agriculture en rapport avec l’environnement et le vivant. A l’orée des années 2000, la pratique de l’agriculture intensive et chimique avait montré tous les risques qu’elle peut créer sur l’infertilité des sols, la pollution des nappes phréatiques et la santé. Par conséquent, ma démarche était dictée à la fois par des considérations gustatives et sociétales.
Quelles sont les contraintes liées au bio, notamment sur les rendements ?
Cela varie au cours du temps et en fonction des années, mais en termes de production céréalière, il y a une diminution de 20 à 30 % du rendement. Ce phénomène se poursuit tout au long de l’élaboration du whisky, puisque la perte existe également sur le rendement alcoolique. En Écosse, par exemple, la moyenne d’alcool pur produit par tonne de malt est d’environ 450 litres, quand notre domaine avoisine plutôt les 300 litres (selon les variétés de céréales). C’est donc une double perte : de production dans les champs et de rendement alcoolique. Mais ces pertes sont, selon moi, aussi des gains. Ce que l’on perd en rendement, il me plaît de croire qu’on le gagne en typicité, en aromatique et probablement aussi en fertilité des sols. L’absence de pollution, la préservation de la beauté des paysages sont des atouts pour mon territoire. J’ai également la conviction d’un gain en terme de goût. C’est aussi pour cette raison que je travaille de la sorte.
L’apport gustatif d’une matière première bio est un sujet débattu, puisque ce ne sont pas les mêmes variétés de céréales qu’en conventionnel. Comment comparer ?
Il convient de prendre la question avec des pincettes. Vous le soulignez avec raison, ce ne sont pas les mêmes variétés d’orge, d’où des profils aromatiques parfois un peu différents. Cependant, cette diversité est en soi intéressante. Même si c’est moins vrai à propos du goût, des études démontrent que les denrées alimentaires sont beaucoup plus riches en oligo-éléments quand elles sont cultivées en bio. D’où mon intuition que ces matières premières vont apporter de la typicité et une richesse, lors des fermentations puis de la distillation, que l’on trouvera moins en conventionnel. Il s’agit plus d’une intuition qu’une affirmation avec des faits scientifiques étayés, même s’il existe un faisceau d’indices en ce sens. En définitive, le dernier mot revient au consommateur, s’il prend du plaisir ou non. Mais, au-delà du bio, nous créons un rapport intime à la matière première : l’équipe a senti la terre, l’odeur de la récolte, des semences, et nous sommes attentifs à la façon dont la céréale se comporte au maltage. Cette connaissance approfondie est mise à profit lors de l’étape de transformation. Si l’on n’a aucune conscience des subtilités de ces nuances aromatiques, il ne sera pas possible de les faire goûter dans le whisky.
_

_
Comment réagissent les autres types de céréales aux pratiques bio ?
Certaines céréales sont plus ou moins rustiques et faciles à travailler en bio. Par exemple, nous possédons dans nos champs un seigle – un cultivar local – très adapté aux pratiques biologiques, car peu sensible aux maladies et aux événements climatiques extrêmes. En outre, il n’est pas gourmand en azote, donc la chimie ne lui sert pas beaucoup. Ensuite, pour les étapes de transformation, nos techniques s’adaptent à chaque céréale : les températures de brassage, les modalités de fermentation, la manière de distiller, et même la façon d’élever en chai. A titre d’exemple, le seigle se caractérise par du fruit, beaucoup d’épices et des côtés un peu terreux et fumé. Pour l’élevage, il convient d’utiliser des bois, des espèces de chêne et des types de chauffe, susceptibles de venir souligner cette typicité ; alors que sur l’orge, plus florale et discrète, des bois s’effaçant davantage sont requis. Un distillateur qui n’a pas ce lien à la matière première et à la terre oublie une partie du travail possible dans le monde du whisky.
Comment l’idée de distiller des céréales plus inhabituelles, comme l’épeautre, est-elle née ?
L’un des atouts d’une ferme-distillerie est la possibilité d’expérimenter. L’orge et le seigle étaient une évidence car nous sommes situés sur un territoire d’alpage et de pastoralisme où ces deux céréales sont présentes, avec une tradition de pain de seigle. Par ailleurs, celles-ci appartiennent au monde du whisky. Cela semblait stimulant de pouvoir réaliser une interprétation dans notre contexte, à notre manière, de ces deux grandes traditions. Ensuite, nous effectuons des rotations sur la ferme, notamment pour des raisons agronomiques. Chaque année, les céréales varient sur le champ afin de se préserver des maladies, d’apporter de la diversité et de puiser un peu moins dans les sols. Cela nous permet de diversifier les plaisirs gustatifs et – un peu comme le vin avec les cépages – de donner à goûter différentes espèces de céréales. L’épeautre procède d’un double choix. D’abord, c’est une céréale méditerranéenne et alpine, avec une histoire locale très forte, et je trouvais pertinent, au moment où l’on inventait un peu un savoir-faire, d’inscrire la distillerie dans cet ancrage. Ensuite, le pain d’épeautre était déjà apprécié par les boulangers, car il offre des arômes intenses. Par conséquent, il m’a paru qu’à la distillation, cette céréale devrait développer une aromatique particulièrement appréciable. Et c’est le cas : l’épeautre propose une aromaticité folle en distillation. Dans cette même idée de rotation et de diversité, nous avons également distillé de l’engrain (ou « petit épeautre », ndla), des avoines nus, des triticales, des blés anciens, même si le triptyque orge, seigle, épeautre reste le cœur de notre chai.
_

_
Les plantes cultivées en bio résistent-elles mieux au changement climatique ?
Au domaine, nous sommes engagés dans ce qu’on pourrait appeler l’agriculture biologique et régénérative, ou agroécologie. C’est une vision agricole un peu holistique, où le vivant prend beaucoup de place, grâce à une attention portée à la biodiversité et la diversité des cultures, ainsi qu’un travail pour améliorer la santé et la vitalité des sols. Par conséquent, ce n’est peut-être pas le bio, stricto sensu, qui peut participer au fait d’être plus volontiers résilient face au changement climatique. En revanche, je suis convaincu – avec des éléments scientifiques dans ce sens – que des logiques agroécologiques ou régénératives contribuent à améliorer la robustesse face à un tel défi. Un écosystème vivant, riche et diversifié sera en mesure d’absorber davantage les chocs, les événements extrêmes. Je le constate sur ma ferme en suivant mes rendements, mais aussi ceux de l’agriculture en Isère. Globalement, mes rendements sont plus bas, même s’ils ont tendance à augmenter avec le temps ; une forme de transition doit s’opérer. En 2020 et 2022, pour la première fois dans l’histoire du domaine, mes chiffres ont été supérieurs au rendement moyen de l’agriculture iséroise – toutes cultures confondues. Ces deux années étaient particulières car des événements climatiques extrêmes ont plombé les résultats de l’agriculture conventionnelle, alors que les miens ont mieux résisté. Certes, d’autres facteurs – dont, notamment, les choix de variétés de céréales plus ou moins résistantes – ont pu intervenir, mais la ferme, comprise comme un écosystème un peu complexe, peut participer, quand elle favorise la biodiversité et la vie des sols, à atténuer les effets du changement climatique.
Les éditions parcellaires procèdent-elles de cette approche du terroir, à l’image de l’univers du vin ?
Le souhait de mettre en valeur la variété de la matière première est venu dès la construction du Domaine des Hautes Glaces. C’est une approche assez vigneronne dans l’âme. À l’époque, l’idée prévalait que le terroir ne comptait pas. Il était, donc, impératif d’asseoir une traçabilité – parcelle par parcelle, variété par variété, millésime après millésime – pour constater si ces éléments avaient du sens dans le monde du whisky. Avec le temps, j’en suis convaincu. Cela fait quelques années que je goûte les effets parcellaires et de millésime en chai et il est évident que cela compte. Mais, encore une fois, tout dépend de la méthode de travail : des whiskies extrêmement boisés vont effacer les spécificités, les subtilités. En outre, les effets parcellaires sont compliqués en agriculture céréalière, car contrairement à la vigne qui est pérenne, les céréales sont annuelles. En outre, elles varient chaque année par rotation. Un amateur de vin, s’il connaît bien certains domaines, peut reconnaître chaque cépage, chaque parcelle : il existe une construction collective extrêmement puissante, entre des centaines, voire des milliers, de vignerons et de dégustateurs qui, chaque année, échangent des informations, livrent leurs sentiments. La récurrence et la redondance des dégustations construisent une idée commune de ce qu’est un cépage, un millésime ; s’il est chaud ou froid. Dans le monde du whisky, nous étions les premiers à proposer des éditions parcellaires et des millésimes. Par conséquent, peu de collègues peuvent comparer leurs productions avec la nôtre. Mais, pour ma part, en chai, j’ai très vite senti l’effet. Sur les parcellaires, il m’a fallu plus de temps. Au début, je ne pouvais pas assurément reconnaître une parcelle d’une autre. Chemin faisant, commence à se dessiner une typicité propre à une ou deux parcelles. Sur un des premiers embouteillages de la collection Epistémè, deux whiskies avaient tout en commun : la variété semée, les recettes de brassage, de maltage et de distillation, les élevages sensiblement identiques ; seule la parcelle différait. Et l’on goûtait les nuances, avec certains marqueurs que je retrouve de manière systématique sur telle ou telle parcelle. A cet égard, j’ai fait déguster deux seigles de la même parcelle à un professionnel du vin et celui-ci m’a dit : « C’est assez fou, si votre seigle était un chardonnay, avec l’un j’ai l’impression d’être en Chablis, et l’autre, en Montrachet ». Là encore, il faudra du temps, mais, selon moi, comme il y a de grands crus dans le vin, il peut y avoir de grands parcellaires dans le whisky.
La notion de terroir dans le whisky est assez récente. Deux écoles paraissent s’affronter : la tradition historique écossaise considère que la matière première n’est pas si importante en comparaison de la distillation et du vieillissement. La conception française, elle, tend à penser le contraire. Est-ce juste ?
Il est évident que nous baignons dans cette culture du terroir – un mot français – tant pour le vin que la gastronomie. Cela compte beaucoup, même en terme d’identité pour un Français. Ce explique certainement pourquoi le concept a émergé de façon plus puissante dans notre pays, même si quelques distilleries dans le monde se réclament désormais d’une approche un peu similaire, à l’image de Waterford. D’ailleurs, leur fondateurs ont, eux aussi, souvent un lien avec l’univers du vin. Toutefois, en France, « terroir » est quelquefois un mot valise, un peu suremployé à des fins marketing. Selon moi, le terroir est une interaction intime entre la matière première et son environnement au sens large. Le terroir est donc l’ensemble de ces interactions, et non pas tel élément pris isolément.
Quelle serait la part de la matière première dans la goût du whisky ?
Quand j’ai commencé, un grand embouteilleur indépendant écossais faisait sa publicité avec pour slogan : »Seul le fût compte » ; j’ai une vision plus systémique. Je ne sais pas dans quelle proportion la matière première influe sur la qualité du whisky car il s’agit d’un processus. Elle peut être entièrement effacée selon la manière dont elle est travaillée. Si le brassage et les fermentations ne servent qu’à extraire de l’alcool, si les distillations ont pour seul objet de concentrer certains goûts, et si l’élevage est extrêmement marqué, alors il y a peu de chance que la qualité de la matière première intervienne. À l’inverse – cela correspond à notre approche – si à chaque étape l’attention à préserver, mettre en valeur, magnifier les subtilités et les qualités propres des matières premières est présente, alors celle-ci exercera une influence considérable sur le whisky. Mais, cela dit, le whisky connaît beaucoup d’étapes de transformation et de facteurs d’influence du champ jusqu’à la bouteille. Dans la mesure où nous jouissons d’une traçabilité totale, il est indéniable que le même liquide, issu d’une matière première identique, s’il est élevé dans deux fûts de nature différente ne produira pas le même whisky. Cependant, à mes yeux, la matière première demeure essentielle – au sens premier du terme – puisqu’elle est à l’origine du produit final. Il y a peut-être ici une dimension plus symbolique, mais le whisky que l’on boit, à l’image des aliments, devient notre corps, puisqu’il sera assimilé, physiquement parlant, mais aussi comme expérience associée à ce que l’on défend, nos convictions. Dès lors, pour moi, la primauté de la matière première relève de cette expérience de vie, de la terre à la terre, pour citer l’Évangile. Cela irrigue l’ensemble du goût.
Le recours aux levures indigènes procède également de cette recherche du terroir ?
Cette démarche s’inscrit dans la continuité de notre travail aux champs et à la distillerie. Le levure est un élément central dans le monde des boissons fermentées et distillées puisqu’ elle transforme la matière première – les céréales – pour apporter de l’alcool et du goût. Nous avions à cœur de nous appuyer, une nouvelle fois, sur les contraintes et les opportunités du territoire ; d’où un long travail pour intégrer et maîtriser des levures sauvages dans nos fermentations. C’est chose faite depuis trois ans : la distillerie est 100 % en levures indigènes et sauvages. Pour y parvenir, nous sommes passés par une étape assez technique : collecter les levures à la main. Ce sont des micro-organismes invisibles, mais présents partout autour de nous. Les épis en maturation dans les champs contiennent des levures. Nous allons les multiplier sur des boîtes de Pétri – c’est une étape de laboratoire – pour ensuite les identifier, réaliser un séquençage ADN et créer ainsi une collection de levures récoltées sur nos champs. Nous créons une sorte de levain naturel (sous forme liquide) et selon les distillations ou les céréales, nous utiliserons soit des levures d’une seule sorte – issue de notre bibliothèque – soit un assemblage de levures.
Comment parvenez-vous à articuler la notion de terroir avec celle de compte d’âge ? Le bois ne risque-t-il pas d’atténuer les expressions de la matière première ?
Nous utilisons beaucoup de bois roux, c’est à dire de vieux fûts déjà épuisés et qui apportent moins d’aromatiques spécifiques liées au bois. Cela permet d’effacer un peu moins le terroir. Peut-être y a-t-il un lien entre la matière première, notre façon de travailler et le vieillissement, car certaines aromatiques, dont je craignais la disparition au fil du temps, persistent pour l’instant. Cependant, nous restons attentifs à cette question et c’est pourquoi il nous arrive de basculer des whiskies en amphore, pour éviter que le bois prenne le dessus. Reparlons-nous dans 10 ou 15 ans pour savoir si, sur de très vieux comptes d’âge, le terroir est encore bien présent, car, pour l’instant, je ne le sais pas encore.
Vous avez une nouvelle malterie. Pourquoi est-ce important ?
Fidèle à notre logique de maîtrise des étapes, le Domaine des Hautes Glaces avait sa propre malterie dès le début. C’est une étape extrêmement importante dans le processus d’élaboration du whisky puisque c’est le moment où l’on se sert de la graine – et de ses capacités vivantes germinative – pour qu’elle offre, par elle-même, sa capacité à se transformer en alcool plus tard. Par conséquent, il existe un ensemble de savoir-faire autour du maltage, de la germination et du séchage – le « touraillage » – qui donne lieu à des possibilités de goût ou d’expression de goût très divers. J’avais donc créé à l’époque une toute petite malterie dans une logique de traçabilité à l’échelle de mes champs, car à l’échelle de l’Europe, ce sont de grosses industries qui mélangent les lots. Pour suivre mon approche parcellaire, il me fallait un outil adapté à la taille de la distillerie, et cette logique se poursuit aujourd’hui, car ce nouvel outil nous permet de malter des lots exactement à la taille souhaitée, d’isoler parcelle par parcelle et aussi d’apprendre à travailler – un peu comme on le fait en brasserie en distillerie ou en élevage – dans une « conversation » avec le grain. En fonction des variétés, des lots de grains, les recettes ne sont pas exactement les mêmes. Nos maltages cherchent à respecter et à conserver la singularité de chaque céréale. C’est pourquoi, notre malt n’est pas fumé ou malté, et l’on n’utilise pas de chauffe lors du touraillage : cela apporte des arômes, certes, fort sympathiques de brioche, par exemple, mais détourne également un peu trop le produit de sa matière première.
Vous proposez également des expérimentations autour des degrés d’alcool. Pourquoi ?
La collection épistémè a été créée pour mettre en bouteille des expériences de dégustation : goûter les parcelles différentes, identifier les facteurs de goût. Le Domaine des Hautes Glaces jouit d’un savoir-faire particulier en matière de réduction et, pour l’illustrer, il nous arrive souvent de proposer des cuvées à des degrés d’alcool différents. On peut trouver un degré d’équilibre intéressant sur une eau de vie particulière, car une certaine aromatique trouvera alors à s’exprimer, et découvrir que le même whisky à un autre degré développera d’autres arômes. Nous consacrons un certain temps à cette question et nous souhaitions la mettre en lumière en choisissant une très belle eau de vie de seigle élevée dans un fût de vin jaune, et proposée à trois degrés d’équilibre différents : à 46 degrés, les caractères fumés typiques du seigle sont assez clairs et les aromatiques propres du fût de vin jaune s’étiolent doucement ; à 52 degrés, le fumé se transforme en épice ; et à 59 degrés, étrangement, on obtient la plus grasse des trois expressions, où l’épice, comme le fumé, sont encapsulés dans une ambiance un peu rancio, patinée. Cela démontre qu’avec la même matière première et le même élevage, ce que l’on retiendra du whisky en bouche va dépendre, également, du degré auquel il est bu.
_____
Pratique | hautesglaces.com