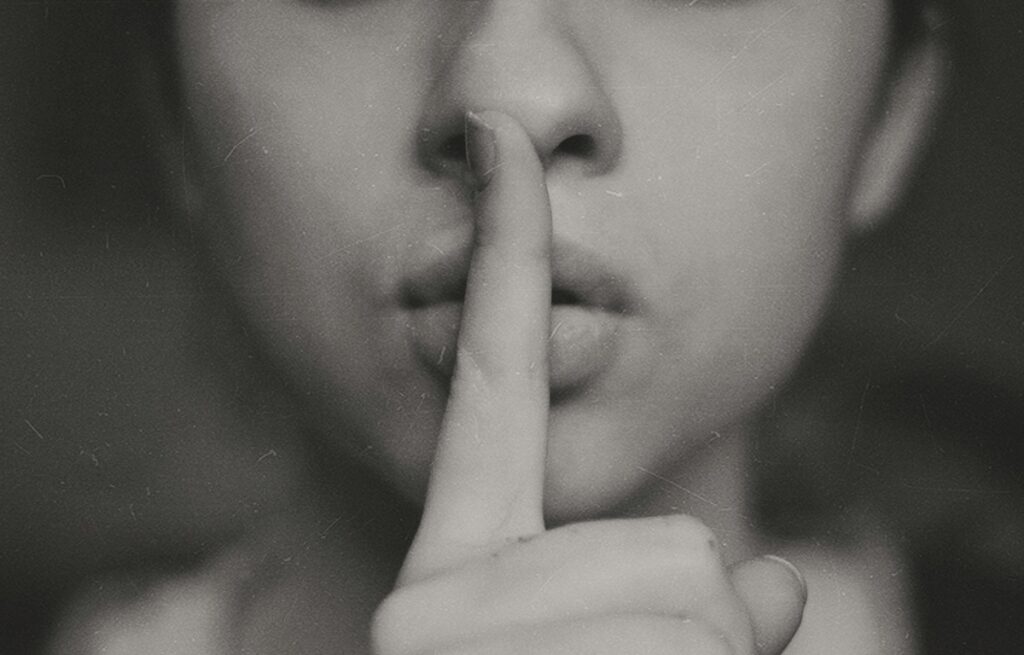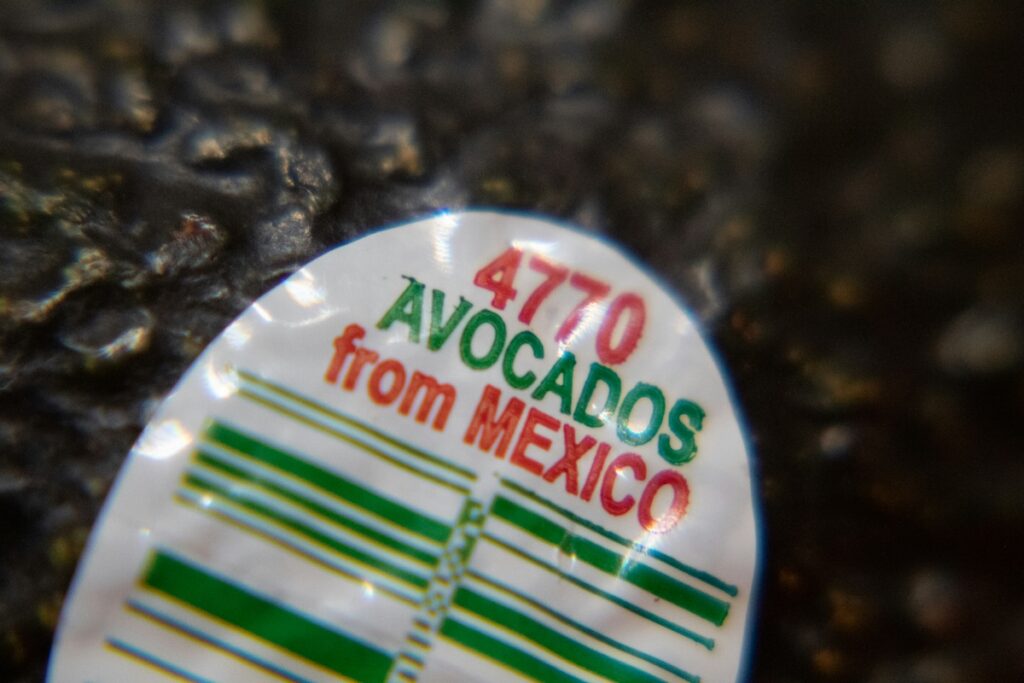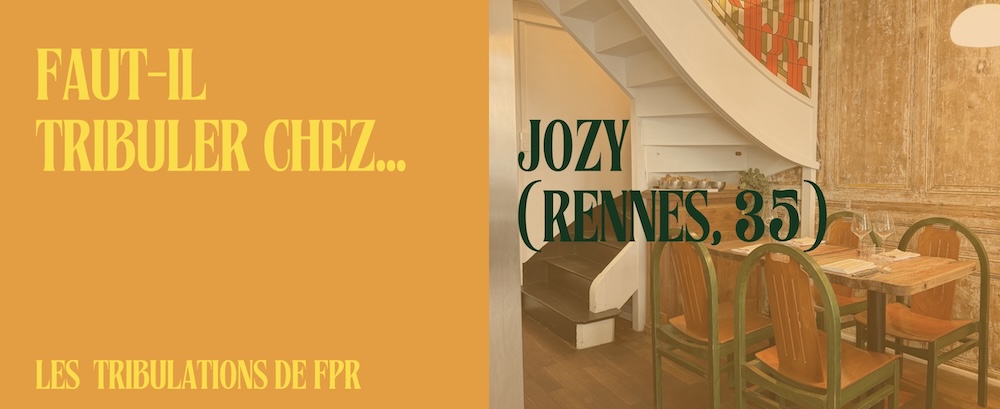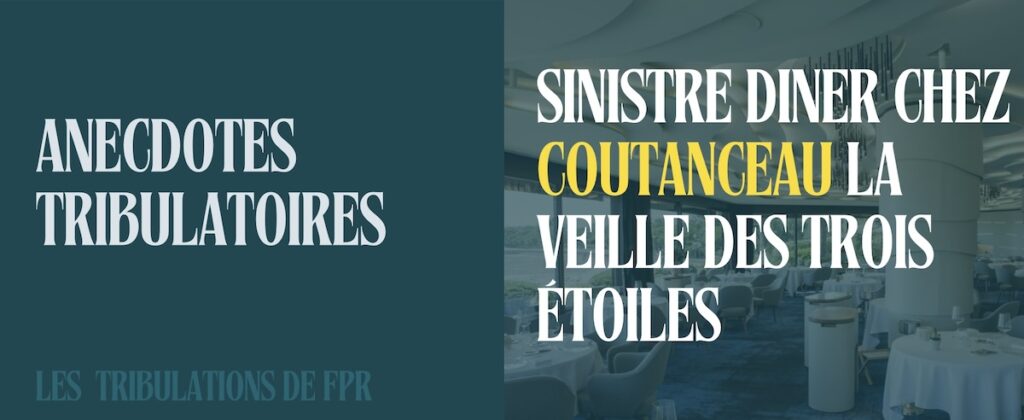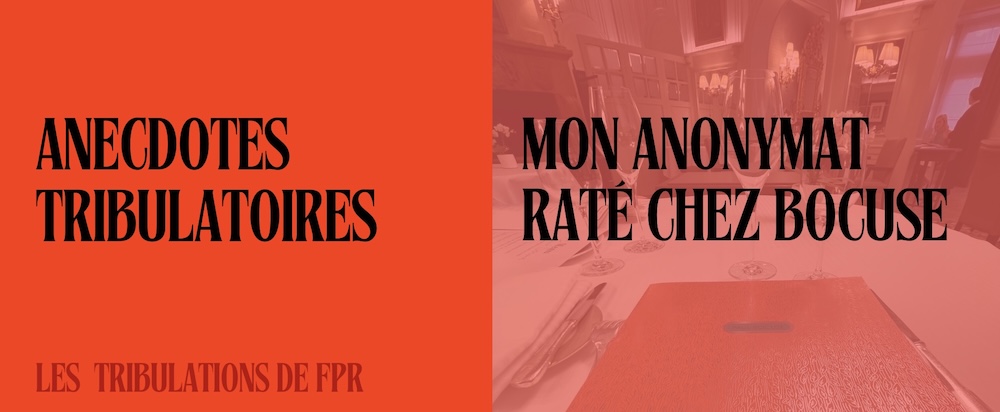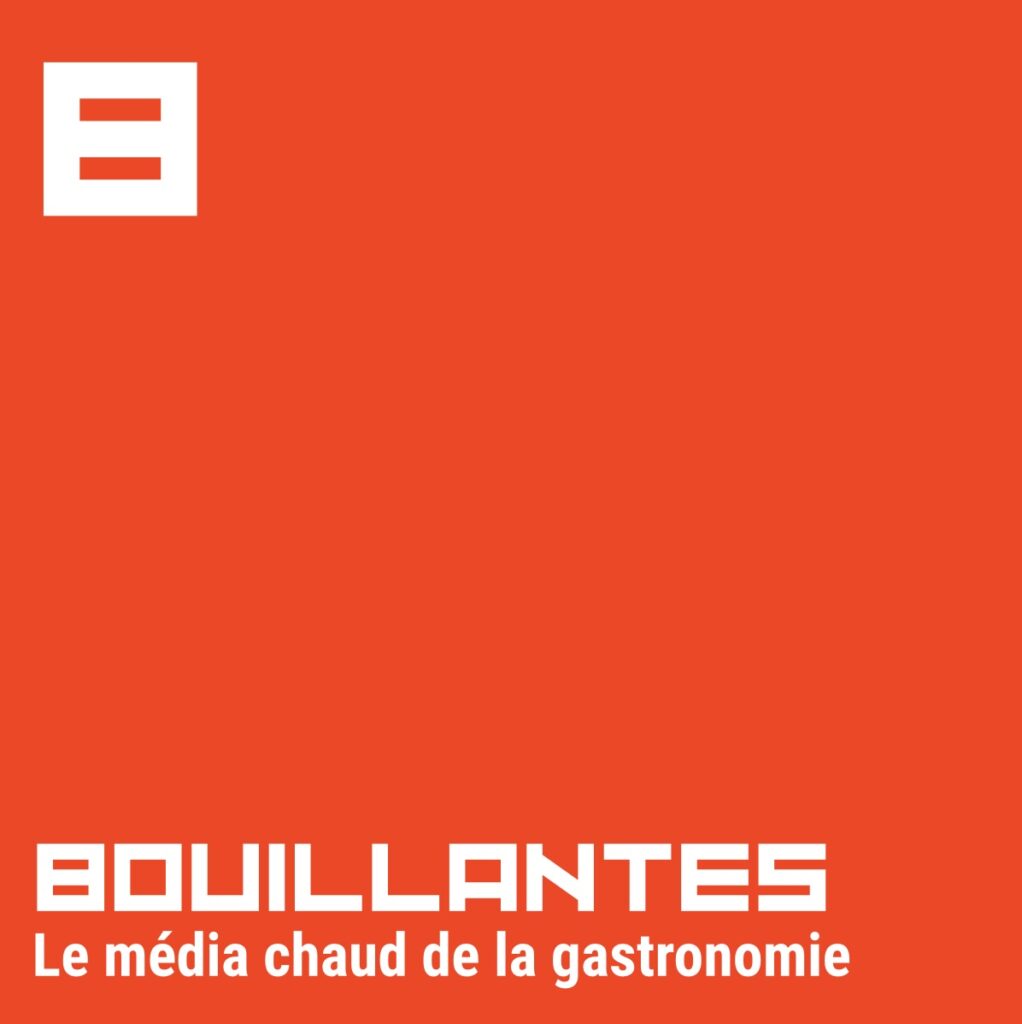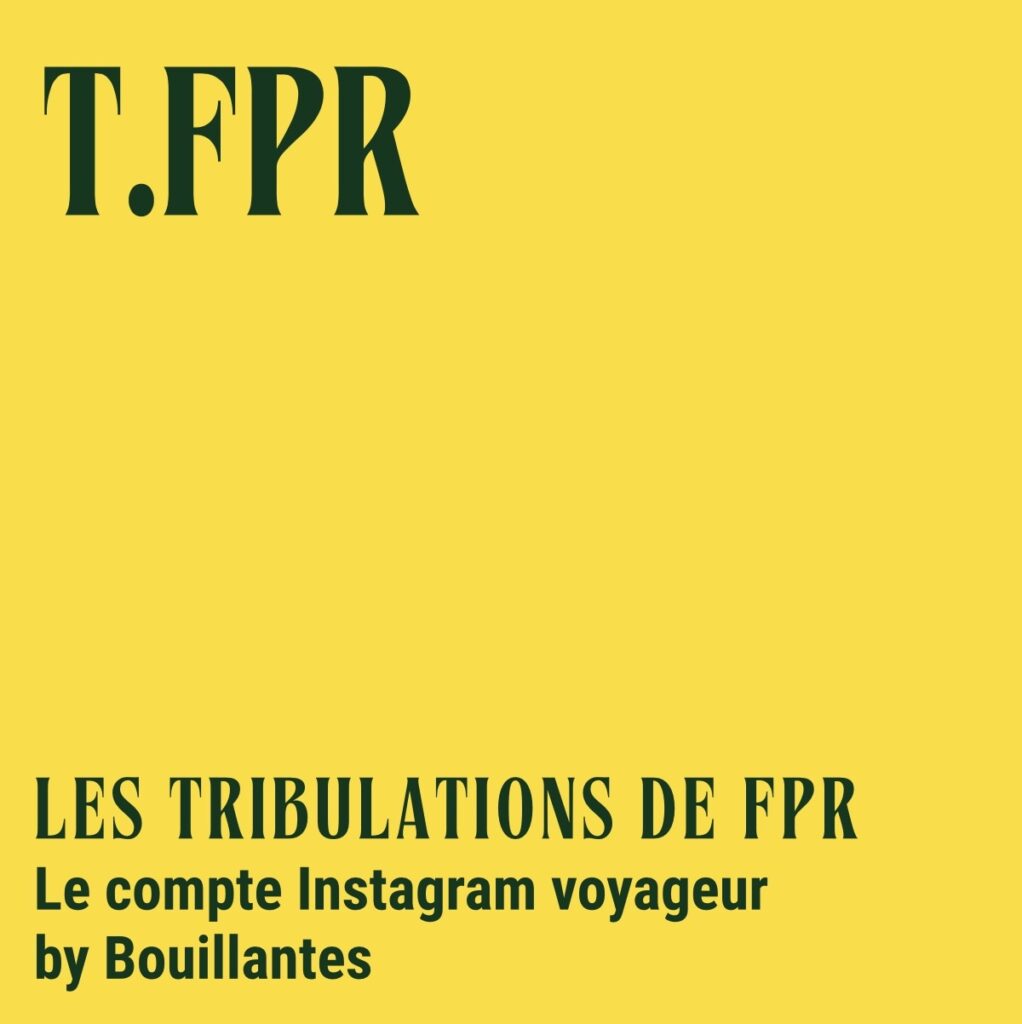CULture-CULinaire est une rubrique d’analyse sociologique dédiée à la culture professionnelle des cuisines.
La sociologue Raphaëlle Asselineau y passe la profession à la moulinette, avec bienveillance, mais sans complaisance.
Au cours de mes recherches sur le travail en cuisine haut de gamme, une chose m’a frappée : les femmes et les hommes n’y font pas exactement les mêmes choses, ni dans les mêmes conditions. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les femmes représentent environ la moitié des élèves en écoles hôtelières, 35% des employés dans la restauration, mais elles ne sont plus que 19 % à occuper des postes de cheffes… et à peine 7 % à la tête de restaurants étoilés.
Cette inégalité ne concerne pas que l’accession aux postes de pouvoir. Elle se voit aussi dans les gestes du quotidien. Lili, par exemple, une jeune demi-cheffe de partie, m’a raconté qu’en plein service, alors que tout le monde s’activait sur les cuissons, on lui a confié l’effeuillage des fleurs. Pourquoi ? Parce qu’elle était la seule femme de l’équipe. Une tâche fine, “délicate”, censée lui correspondre, alors qu’elle aussi voulait « rôtir la volaille ». C’est ce qu’on appelle un stéréotype de genre : croire que certaines qualités – comme la douceur ou la patience – seraient “naturelles” chez les femmes. Ces qualités, souvent jugées « féminines », sont plutôt dévalorisées dans les hiérarchies professionnelles. À l’inverse, la résistance au stress, le leadership ou la force physique – perçues comme “masculines” – sont associées au cœur du métier.
Ce travail relationnel et émotionnel, pourtant essentiel au bon fonctionnement d’une brigade, n’est ni valorisé, ni reconnu comme une compétence. Et encore moins rémunéré.
J’ai entendu de nombreux autres récits semblables : des femmes orientées d’office vers la pâtisserie car « plus délicate », des hommes qui portent les charges lourdes sans qu’on leur demande, pendant qu’on propose poliment aux femmes de se faire aider. Et toujours, des remarques sur leur supposée sensibilité, émotion, fragilité – censées être difficilement compatibles avec le rythme du service.
Mais il ne s’agit pas seulement de ce qui se voit dans l’organisation du travail. Il y a aussi tout un travail invisible, souvent assumé par les femmes : écouter les collègues, calmer les tensions, rassurer un(e) apprenti(e) en difficulté, veiller à l’ambiance de l’équipe. Ce qu’on appelle le care – c’est-à-dire le travail du soin aux autres – repose largement sur elles. Ce travail relationnel et émotionnel, pourtant essentiel au bon fonctionnement d’une brigade, n’est ni valorisé, ni reconnu comme une compétence. Et encore moins rémunéré. Des chefs m’ont confiée le déléguer volontiers, sans en mesurer le coût réel : charge mentale, fatigue, stress émotionnel… Comme si ces tâches “allaient de soi” pour les femmes. Exemples : envoyer une femme parler à untel qui traverse un coup de mou, ou demander à une femme d’accompagner un employé étranger à la préfecture pour ses démarches administratives…
Evidemment, cela ne signifie pas que tous les restaurants sont concernés, ni que tous les hommes se comportent ainsi. J’ai rencontré, au contraire, des chef(fes) qui travaillent autrement, avec respect, écoute et partage. Ce sont souvent celles et ceux qui réfléchissent à leur posture, à leurs pratiques, à la culture du métier.
Mon objectif dans cette enquête n’était pas de juger, mais de comprendre. Comprendre pourquoi ces inégalités persistent, parfois sans même que les équipes s’en rendent compte. Comprendre comment des habitudes, des gestes, des réflexes peuvent, sans malveillance, reconduire des logiques sexistes. Et comment, aussi, on peut les déconstruire ensemble, parce que tout n’est pas figé, et oui (chef-fes !) on peut faire autrement !
Pour aller plus loin
Pierre Bourdieu, La Domination masculine (1998)
Le sociologue montre comment certaines tâches dites « féminines » (comme la cuisine ou le soin) changent de valeur lorsqu’elles sont reprises par des hommes dans l’espace public. Il écrit : « Il suffit que des hommes s’emparent de tâches réputées féminines et les accomplissent hors de la sphère privée pour que celles-ci se voient immédiatement ennoblies et transformées. »
Arlie R. Hochschild, Le prix des sentiments (2003)
Une analyse fondatrice du travail émotionnel : ce travail invisible (écoute, soutien, gestion des émotions) largement porté par les femmes, souvent dans des métiers de service, et rarement reconnu à sa juste valeur.
_
Suivre Raphaëlle Asselineau et Equality Lab sur les réseaux :
Sur Instagram
Sur Linkedin
_
Sur le même sujet | Lire les autres articles Cul-Cul
Photographie | Adri Ansiah